Plateformes numériques et souveraineté
Maximilien Lanna (dir.)
Les plateformes numériques ont acquis, ces dernières années, des pouvoirs souvent comparables à ceux des États. Placées en situation de quasi-monopole, elles sont désormais en mesure de concurrencer les activités traditionnellement réservées au domaine régalien, allant jusqu’à s’approprier certains attributs de la souveraineté.
Face à ce phénomène et sous l’impulsion de l’Union européenne, le droit évolue et tente d’encadrer l’activité des plateformes. Différentes réformes contribuent, non sans difficultés parfois, à faire émerger un modèle européen et harmonisé de régulation du numérique.
Une stratégie d’envergure portant sur les données est mise en oeuvre. Elle entend favoriser leur libre circulation et empêcher leur captation exclusive par un nombre restreint d’entreprises. De nouvelles règles de concurrence sont également en cours d’adoption, afin d’encadrer les déséquilibres structurels qui
caractérisent ces opérateurs. Des mesures sectorielles complètent ce dispositif, en raison du caractère particulièrement perturbateur des plateformes.
Ces évolutions semblent témoigner d’une dynamique plus générale. Une réponse globale semble en effet se dessiner aujourd’hui pour encadrer l’activité des plateformes et ainsi garantir à l’État une véritable souveraineté numérique.

Pouvoirs et influences au Conseil constitutionnel
Thomas Perroud
Le Conseil constitutionnel a été conçu comme "un chien de garde de l'exécutif", un "canon braqué contre le Parlement". Son rôle a évolué. En 1971 il a intégré le respect de la Déclaration des droits de 1789 dans son champ de compétences. Et en 2008 une voie nouvelle a été ouverte : la question prioritaire de constitutionnalité. Organe majeur de nos institutions l'opacité de son fonctionnement et de ses procédures, y compris de nomination, n'est pas sans poser problèmes
Les récentes nominations au Conseil constitutionnel ont ravivé les polémiques sur le rôle secondaire de la compétence juridique dans les critères de sélection. Pourquoi ? Ce livre apporte une réponse en expliquant les jeux de pouvoir à l'oeuvre à l'intérieur et à l'extérieur du Conseil. À l'intérieur le processus décisionnel est largement capté par les bureaux. À l'extérieur, le manque de procédure a conduit à des jeux de pouvoir entre le juge, la "partie" chargée de défendre la loi, et les lobbies. Et cette structure de pouvoir au sein de la juridiction désavantage la Parlement et les juges, qui se trouvent marginalisés.

Les Crises. Perspectives croisées entre droit et science politique
Julie Saniez, Jonas Weko (dir.)

Crise sanitaire, crise de la démocratie, crise de l’État social, crise du multilatéralisme... La notion de crise est devenue omniprésente dans les discours scientifique, politique et courant. Cet ouvrage cherche à en saisir la réalité et les enjeux en se positionnant sous le double prisme de la science politique et juridique. Loin du « mot-valise », la crise est traitée comme un révélateur et un accélérateur des transformations institutionnelles. L’analyse met d’abord en lumière les tensions qui traversent l’État et son administration : la quête de performance, inspirée du New Public Management, fragilise les repères professionnels et accentue la désorganisation des services publics. Elle examine ensuite la capacité de l’État social à encaisser les chocs, entre résilience et recours à des régimes d’exception qui bousculent l’État de droit. Enfin, un regard décentré vers l’international aborde notamment, la régulation multipolaire du droit d’asile au Maroc et la crise de la coopération monétaire franco-africaine. Les crises apparaissent ainsi comme des épreuves formatrices qui redessinent durablement les contours et les missions de l’État contemporain.
Art séquestré : Les marbres du Parthénon, le panache de Moctezuma et autres histoires cachées de nos musées
Catharine Titi, Katia Fach Gómez
Derrière de nombreuses œuvres que nous admirons lorsque nous visitons le Louvre, le British Museum ou le Met de New York se cache un passé inconfortable. Ce sont des pièces qui ont disparu de leur lieu d'origine, arrachées à des temples, des tombes ou des palais, et qui font aujourd'hui l'objet de revendications.
Pendant des siècles, les grands musées ont rassemblé des objets provenant des quatre coins du monde, convaincus de préserver le patrimoine de l'humanité. Mais derrière cette apparence d'universalité se cache une histoire de conquêtes, de pillages et d'appropriations qui continue de peser sur nos institutions culturelles.
Cet ouvrage retrace le parcours de six pièces emblématiques — des marbres du Parthénon au panache de Moctezuma, en passant par les bronzes du Bénin et le buste de Néfertiti — afin d'expliquer, avec rigueur et clarté, comment elles sont arrivées dans les salles d'exposition où elles se trouvent aujourd'hui et d'ouvrir le débat sur leur restitution.

La privatisation de l'espace public
Marie Cirotteau (dir.)

Ni cantonné au périmètre du domaine public, ni nécessairement soumis au régime de la propriété publique, l’espace public échapperait à toute tentative de définition juridique univoque. Sa privatisation permet paradoxalement de mieux saisir juridiquement ce concept central de la théorie politique de la démocratie, qui interroge les conditions de l’égalité entre les citoyens.
Sa plasticité ainsi que le renouvellement des pratiques sociales – externalisation de la gestion et du contrôle dans l’espace public, laïcisation, collectivisation des espaces ou encore commercialisation de l’image de biens publics – conduisent à constater un brouillage des frontières entre l’espace public et l’espace privé.
Cet ouvrage, qui réunit de jeunes chercheurs en droit, permet d’illustrer le caractère protéiforme de la privatisation de l’espace public et d’interroger l’intensité de ce phénomène, les droits qui s’y expriment et les logiques qui le justifient.
L'interdiction des " thérapies de conversion sexuelles" - lutter contre les tentatives de guérir l'homosexualité
Jimmy Charruau, Daniel Borrillo et Thomas Perroud (dir.)
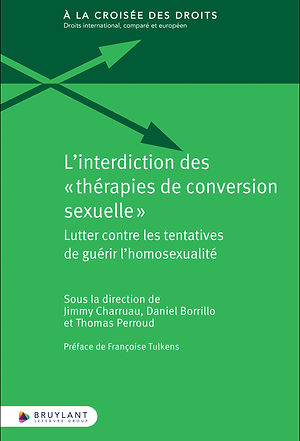
Chocs électriques, traitements médicamenteux ou psychiatriques, exorcismes…
Derrière l’expression trompeuse de « thérapies de conversion sexuelle », se cachent des pratiques variées visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne pour la rendre hétérosexuelle ou conformer son genre à son sexe biologique. Autrefois réalisées principalement dans le milieu médical, elles trouvent aujourd’hui un nouveau terrain d’expression, sous d’autres formes, notamment dans certains courants religieux.
Face à cette réalité aux conséquences humaines dramatiques, de nombreux États ont légiféré pour interdire expressément ces pratiques. Ce phénomène normative interroge : comment, en fonction des cultures et systèmes juridiques nationaux, l’interdiction varie-t-elle dans son principe et sa formulation ? Jusqu’où le droit peutil intervenir sans rompre l’équilibre nécessaire résultant de la conciliation entre l’autodétermination, les libertés d’expression et de religion, le principe de non-discrimination ou encore le respect de l’autorité parentale ? Après avoir dressé un panorama de la variété et de l’évolution des pratiques, cet ouvrage s’inscrit dans une démarche juridique : il procède d’abord à l’analyse des textes produits aux niveaux international et régional, puis étudie les nombreuses législations nationales, avant de mettre en perspective ces interdictions en les confrontant aux droits et libertés en jeu. Suivant une approche comparatiste et interdisciplinaire, cet ouvrage inédit s’avère essentiel pour comprendre les enjeux politiques et sociaux que soulèvent ces pratiques et interroger les limites du droit face à leur persistance.
La confiance et l'Etat - Regards croisés en droit public et science politique
Mathilde Guyot et Pauline Hérold (dir.)
De la mobilisation des « Gilets jaunes » à l’escalade des propos haineux visant les élus, les illustrations de la défiance des citoyens envers l’État se multiplient. Cet ouvrage collectif décrypte, avec le regard croisé de juristes et de politistes, les mécanismes de cette perte de confiance : d’où provient-elle ? Comment s’exprime-t-elle vis-à-vis de l’élaboration de la loi, de la perception de l’impôt ou de l’organisation des services publics ?
L’ouvrage passe au crible les réformes mises en oeuvre pour tenter de renouveler cette confiance : renforcement des pouvoirs locaux et de la transparence de l’administration publique, participation des citoyens aux décisions des autorités administratives… Autant de propositions prometteuses, mais dont certaines limites doivent être soulevées.
Enfin, une perspective extérieure est proposée, visant à sonder les dimensions extra étatiques de la confiance, des relations entre l’Union européenne et les citoyens jusqu’au rôle des communs comme vecteurs de confiance citoyenne.

Le pouvoir administratif des personnes privées
Marie Cirotteau
Le pouvoir administratif des personnes privées n’est pas une « monstruosité » du droit administratif, mais une notion originale qui désigne la capacité des personnes morales de droit privé à prendre des actes juridiques.
Ce pouvoir se traduit par la détention de fonctions de police administrative spéciale, par des personnes privées, qui s’exerce sur les opérateurs économiques. Par opposition avec la théorie normativiste qui associe l’acte juridique à la volonté, plusieurs exemples sélectionnés dans le droit positif permettent de penser ce phénomène en s’appuyant sur la théorie du pouvoir.
L’auteure applique un régime, qui s’inspire des principes irriguant le droit administratif, au pouvoir administratif des personnes privées, et questionne son encadrement par les méthodes du contentieux administratif. Elle propose finalement d’introduire une logique concurrentielle dans les secteurs où ce pouvoir fait irruption et perturbe le fonctionnement des marchés. Ce faisant, Marie Cirotteau nous invite à repenser les conditions qui ont construit le savoir juridique, et propose des réponses inédites face aux défis posés par l’accroissement du pouvoir de certaines grandes entreprises aujourd’hui.
Prix de thèse de l’Université Paris-Panthéon-Assas
Mention du Prix Marie-Dominique Hagelsteen


Le droit de l'intelligence artificielle
Lucie Cluzel-Metayer
L’intelligence artificielle inquiète autant qu’elle fascine. Irriguant aujourd’hui presque toutes les activités humaines, elle transforme en profondeur la société et, plus encore, l’humanité. L’objectif de ce petit ouvrage serait d’expliquer ce que recouvre précisément la notion d’IA, d’en présenter quelques cas d’usages emblématiques, en France et à l’étranger (pour l’attribution de crédit dans le secteur bancaire, pour le recrutement, la police, la justice, la santé…), d’en expliquer les potentialités mais aussi les risques, afin de comprendre l’importance de règlementer le recours à l’IA.
From the Entente Cordiale to New Ententes
E. Gibson-Morgan, G.Gadbin-George (dir.)
Cet ouvrage fait suite à un colloque international organisé à Paris (France) en mai 2024 pour célébrer le 120e anniversaire de l'Entente Cordiale. Grâce aux contributions d'universitaires (historiens français, britanniques et américains), de juristes et de diplomates, il offre, pour la première fois dans le Royaume-Uni post-Brexit, une perspective nouvelle, transnationale et multidisciplinaire sur l'Entente Cordiale. Son objectif principal est de mieux comprendre l'Entente Cordiale originelle – en expliquant son origine et sa nature – mais aussi ce que l'Entente signifie aujourd'hui – et ce qu'elle pourrait signifier demain

Reconnaissance faciale. Défis techniques, juridiques et éthiques
M. Bozzo-Rey; A. Brunon-Ernst; C. Wrobel
Le 21e siècle vivra-t-il l’avènement d’une « société de la reconnaissance faciale » différente de la « société de surveillance » ? Quels défis pose cette technologie de contrôle social, source à la fois de fascination et de méfiance, sur les plans technique, juridique et éthique ? Quel type d’identité, voire de subjectivité, vise-t-elle réellement ? Par quelle conception de l’espace social et des relations interpersonnelles dans la sphère publique son utilisation est-elle sous-tendue ?
Afin de proposer des éléments de réponse, les contributions rassemblées au sein de cet ouvrage pluridisciplinaire reviennent sur la conception et le déploiement des techniques de reconnaissance faciale ainsi que sur les tentatives de réglementation actuelles, tout en proposant des outils de réflexion critique, mobilisant et revisitant notamment les notions de consentement et d’anonymat.

Droit de l'aide et de l'action sociales, 12ème édition
M. Borgetto, R. Lafore

Conçus comme compléments de la Sécurité sociale à destination de fractions ciblées de la population (enfance en danger, personnes âgées, handicapées…), les dispositifs nés des lois d’assistance de la IIIe République connaissent, depuis plusieurs décennies, un développement continu. L’émergence des phénomènes d’exclusion, les effets du vieillissement et de la dépendance, l’enracinement de difficultés diverses en matière d’accès au logement, à l’emploi ou encore aux soins ont conduit non seulement à renforcer les politiques d’aide aux catégories traditionnelles de l’assistance, mais aussi à développer des interventions de plus en plus complexes pour assurer à minima la concrétisation de droits sociaux élémentaires.Cet ouvrage propose une approche compréhensive de ces politiques et de ces interventions : loin de s’en tenir à une description du droit positif, il s’efforce au contraire de les situer dans leurs cadres théoriques, d’analyser leurs déterminants socio-politiques, d’en comprendre les enjeux et de fournir ainsi des éclairages débouchant sur la réflexion et l’action. Cette douzième édition prend en compte les nombreux changements et mutations survenus depuis trois ans ou en cours de réalisation : réaménagement des compétences au niveau local, amélioration de la politique de protection de l’enfance, création d’une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, adoption de mesures visant à lutter contre la maltraitance, à favoriser le « bien vieillir », à réorganiser les services d’aide à domicile ou à restructurer l’allocation aux adultes handicapés, modification du régime du RSA et inflexion des politiques de lutte contre la pauvreté, durcissement accru du système d’indemnisation du chômage…
Womanhoods and Equality in the United States. 20th-21st Century Perspectives
C. Bryson, A. Légier, A. Ribieras
Womanhoods and Equality in the United States explores how the idea of equality has evolved along with the debates that have animated contemporary American women’s history.
This book argues that “womanhood” is neither a unified concept nor a monolithic experience but rather a multifaceted notion. This collection thus looks at this plural dimension of womanhood—womanhoods—with a special focus on equality as a common goal. The authors question what equality means depending on many factors such as race, class, sexuality, education, marital or parental status, physical appearance, and political orientation, and address timely issues including abortion rights, Black womanhood, and sexual violence on college campuses.
Womanhoods and Equality in the United States is an essential resource for academics and students in gender studies, American sociocultural history, and the sociology of social movements.

La Justice pénale numérique en France et au Royaume-Uni
G. Gadbin-George, A. Taleb-Karlsson (dir.)
La justice pénale numérique déployée des deux côtés de la Manche a connu un essor incontestable à la suite de la pandémie liée à la Covid-19. Si les avantages du dispositif sont réels à de nombreux égards (gain de temps, de ressources et d’argent), l’impact de l’usage des nouvelles technologies sur la mise en œuvre des droits fondamentaux doit être étudié. En effet, il apparaît que les droits fondamentaux dont bénéficie la personne impliquée dans une procédure pénale peuvent se trouver affectés dans un contexte où l’étendue et les garanties de la numérisation de la procédure font débat au plan interne comme au plan européen.
Dans ce contexte juridique renouvelé par l’évolution des droits pénaux nationaux, français et anglais, et des droits européens, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, de nombreux questionnements demeurent s’agissant des défis à relever en France et au Royaume-Uni mais également dans les relations qu’entretiennent ces deux États en Europe.

Les communs sans tragédie. Ecologie, démocratie, sphère publique
T. Boccon-Gibod, T. Perroud (dir.)

Depuis plusieurs années, le concept de « communs » s’est imposé pour contester le paradigme de la propriété, tant publique que privée. En effet, davantage encore que celui de « biens communs », celui-ci n’évoque pas seulement des pratiques d’appropriation (fussent-elles collectives), mais aussi bien de simples relations sociales, des manières alternatives de se rapporter au monde. Par là même, à l’heure des défis écologiques, il invite à subvertir les fondements anthropologiques de la pensée économique traditionnelle et à reformuler notre compréhension tant de la sphère privée que de la sphère publique.
Saisissant l’occasion de la première traduction française de l’article pionnier de la juriste états-unienne Carol Rose, « La comédie des communs » (1986), le présent ouvrage entend montrer que, loin d’être voués à l’échec et à la tragédie, les communs sont porteurs de promesses dont la portée n'a pas encore été entièrement mesurée.
Avec les contributions de : Thomas Boccon-Gibod, Marie Alice Chardeaux, Pierre Crétois, Aude-Solveig Epstein, Chloé Gaboriaux, Florent Masson, Thomas Perroud, Carol Rose.
Droit de la sécurité sociale 20ème édition
M. Borgetto, R. Lafore
Cette nouvelle édition se veut fidèle à ce qui fait, depuis l'origine, la particularité de ce Précis : exposer de façon complète et détaillée le système français de sécurité sociale en rendant compte non seulement des règles juridiques qui régissent son fonctionnement, mais aussi du contexte social et économique, national et international, qui détermine son organisation.
Une première partie, en forme de « théorie générale », se propose de faire ressortir les principales évolutions et caractéristiques du droit de la sécurité sociale ainsi que les grands problèmes auxquels il se trouve aujourd'hui confronté. Une seconde partie s'attache à analyser ce qui en fait la matrice — en l'occurrence, le régime général —, tandis qu'une troisième et dernière partie entreprend de présenter les autres régimes venant compléter l'ensemble.
L'ouvrage intègre les divers changements survenus depuis la précédente édition : réforme des régimes de retraite et d'indemnisation du chômage, instauration d'une branche Autonomie, création de la Complémentaire santé solidaire... sans oublier quantité d'autres ajustements ayant affecté l'organisation et le financement du système.
Le Précis entend ainsi fournir à ses utilisateurs - étudiants, chercheurs, professionnels, usagers... - les matériaux nécessaires pour appréhender un droit certes complexe et mouvant, mais plus que jamais crucial pour la vie de chacun comme pour le devenir de l'ensemble de la société.

L'Etat post-moderne 6ème édition
J. Chevallier

L’émergence de l’État post-moderne a marqué l’infléchissement, à la fin du XXe siècle, du principe de souveraineté inhérent à la construction de l’État moderne : inséré dans des liens complexes d’interdépendance, exposé à la concurrence de pouvoirs multiples, traversé par de nombreuses lignes de fracture, l’État perd son omnipotence. La mondialisation a poussé à partir des années 1990 à la diffusion de cette nouvelle configuration étatique.
L’État post-moderne ne dispose cependant pas d’une essence stable : il a toujours comporté diverses potentialités et ses équilibres varient, non seulement d’un pays à l’autre, mais encore en fonction du contexte. Un mouvement réactif s’est produit au cours des dernières années, tendant à la restauration d’éléments du modèle étatique traditionnel : l’aggravation dans la société contemporaine des facteurs de crise et l’existence de menaces de toute nature conduisent à remettre l’État au centre du jeu social, en tant que garant de la sécurité collective.
Par ailleurs, l’État post-moderne est désormais confronté à des modèles concurrents, rompant avec les valeurs dont il se réclame : à la vision d’un ordre mondial pesant comme contrainte sur les États s’oppose celle d’un ordre international basée sur la souveraineté des États ; et contre le modèle de démocratie libérale, on voit s’affirmer une conception différente de l’organisation politique, ne reposant plus sur l’affirmation des droits de l’homme et le respect du droit.
Smart city et prise de décision
M. Lanna, E. Py (dir.)
« Le fonctionnement actuel des villes repose sur un ensemble hétérogène de prises de décisions : l'automatisation de ces procédés, grâce au numérique, soulève de nouveaux enjeux, juridiques, sociologiques et économiques. »
La ville intelligente, pour permettre la transformation et la rationalisation de certains services, se nourrit de données. Données à caractère personnel ou données techniques, ces informations ont pour but d'appuyer le processus décisionnaire au sein des villes : elles en deviennent le principal carburant et permettent ainsi d'alimenter certaines techniques d'analyse. Interrogeant les sources du droit et de la régulation, ces techniques posent aussi la question de la gouvernance des villes. Les individus, ayant vocation à devenir acteurs des transformations urbaines, ne sont plus seulement des usagers de la ville. Ils s'insèrent dans un environnement complexe reposant sur la collaboration d'entités publiques et privés.

La morale ou le droit? Prostitution, hijab, gestation pour autrui, euthanasie, pornographie...
Daniel Borrillo

Articulé autour de la liberté et illustré par les controverses sociétales qui ont marqué les dernières trois décennies de la vie politique française, cet essai constitue une plaidoirie pour la libre disposition de soi et toutes les libertés qui en découlent : liberté procréative, liberté sexuelle, liberté religieuse, liberté d’expression, liberté vestimentaire… Du Pacte civil de solidarité à l’interdiction de la burqa, du changement de sexe à l’état civil au mariage pour tous, de la pénalisation des clients des prostituées au maintien de la prohibition du suicide assisté en passant par la pornographie, la gestation pour autrui ou encore le blasphème, ces débats ont mis en évidence la difficulté de notre société à assumer le principe politique qui l’a pourtant fondée, à savoir que l’État n’est légitime à intervenir que pour empêcher qu’un tort soit causé à autrui. Autrement dit, vis-à-vis de soi-même aucun pouvoir, aucune autorité ne saurait se substituer à l’individu sous peine de compromettre le contrat social. Affirmer la libre disposition de soi constitue l’acte premier de résistance envers toutes les formes d’assujettissements.
Services publics et communs. A la recherche du service public coopératif
Thomas Perroud
Le Bord de l'eau, coll, Documents, 2023, ISBN 9782356879592, 222 p.
Face au déficit démocratique qui affecte notre pays, l'objet de cet ouvrage est de déplacer le regard des institutions politiques vers l'ensemble des institutions qui forme le tissu du vécu citoyen : les services publics. C'est d'abord par la radicalisation de la démocratie administrative que l'on pourra régénérer notre système politique. L'objet de cet ouvrage est donc de confronter la notion française de service public aux recherches sur les communs. Il faut renouveler la réflexion sur es services publics en abandonnant la question de la propriété du service public (étatique ou privée) et, plutôt, nous interroger sur sa gouvernancee. Le débat est simple : comment pourrait-on fournir des services publics sur une base démocratique et inclusive, l'idée centrale qui anime les communs ? Émerge ainsi en Europe une nouvelle forme, la coopérative de service public, qui nous semble tout indiquée pour donner forme à la fourniture inclusive des services d'intérêt général.

L'état de droit - 7ème ed.
Jacques Chevallier
LGDJ, coll. Clefs, 2023, 7ème ed., 168 p., ISBN : 9782275131221

Forgée à la fin du xixe siècle dans la doctrine juridique allemande puis transposée en France pour répondre à l’exigence de fondation du droit public, la théorie de l’État de droit a connu au xxe siècle de sensibles inflexions : le défi totalitaire a conduit au dépassement de la conception purement formelle, reposant sur l’idée de hiérarchie des normes, au profit d’une conception substantielle privilégiant la garantie de la sécurité juridique et des libertés fondamentales.
Si l’État de droit a été à partir des années quatre-vingt promu au rang de standard international, auquel tout État est tenu de se conformer, l’édifice est resté fragile.
Le reflux du modèle politique libéral à partir des années 2000 a contribué à mieux marquer les limites d’une vision qui avait été trop vite parée des attributs de l’universalité. Dans les pays libéraux eux-mêmes, la croyance dans les vertus de l’État de droit a tendu à s’effriter au cours des dernières années, sous la pression de menaces nouvelles.
The Parthenon Marbles and International Law (Les marbres du Panthéon et le droit international)
Catharine Titi
Springer, 2023, XVIII p., 313 p., ISBN : 978-3-031-26356-9 (en anglais)
Le différend entre la Grèce et le Royaume-Uni concernant la restitution des marbres du Parthénon exposés au British Museum est le plus connu des différends internationaux en matière d’antiquités pillées. Il a divisé l’opinion publique depuis qu’un diplomate britannique, Lord Elgin, a fait arracher les marbres de l’ancien temple au tournant du XIXe siècle à Athènes, qui se trouvait à l’époque sous occupation ottomane, pour les envoyer à Londres. En 1816, criblé de dettes, Elgin s’est vu obligé de les vendre au gouvernement britannique, qui les a confiés au British Museum, où ils sont désormais exposés. Cet exil forcé des marbres du Parthénon a suscité de nombreuses polémiques et débats. Cependant, les arguments juridiques relevant du droit international en faveur de leur retour n’ont jamais été pris en compte. Pour la première fois, un ouvrage examine ce différend au regard des exigences du droit international et apporte un éclairage sur le nouveau cadre juridique de la protection du patrimoine culturel.
Les Groupes d'intérêt en France
Courty G., Milet M.
classiques garnier, 688 p., ISBN 978-2406132950
Cet ouvrage est le premier depuis soixante ans à proposer un panorama de l'action des groupes d'intérêt dans la vie politique française en s'appuyant sur les recherches menées par les chercheuses et chercheurs spécialistes de ces questions. L'objectif des dix-huit chapitres et des dix focus est double : faire découvrir les transformations institutionnelles les plus récentes, dont la loi sur les représentants d'intérêts, tout en les inscrivant dans l'histoire politique contemporaine depuis la Révolution. Toutes ces contributions permettent d'approfondir les spécificités du rôle joué par les groupes d'intérêt en France ; de comprendre les relations qu'ils entretiennent avec le pouvoir politique et de saisir leurs pratiques et répertoires d'action.


L'état en France. Entre déconstruction et réinvention Jacques Chevallier
Gallimard, 96 p., ISBN 9782073006103
Chacun le sait, la société française se distingue notamment par le rôle essentiel que l’État a tenu dans sa construction et son développement. Or, dans la dernière période, la mondialisation économique, la construction européenne, la montée de l’individualisme ont fortement remis ce rôle en question. Jusqu’à quel point ? Jacques Chevallier, éminent juriste auquel on doit des études classiques sur L’État de droit ou L’État post-moderne, dresse le bilan des évolutions qui ont ébranlé ce modèle ancré dans l’histoire. Un modèle peut-être plus souple qu’on ne pouvait croire et qui, loin de disparaître, montre-t-il, s’adapte et se réinvente à l’heure des défis inédits du contexte politique et des nouvelles technologies.

La vie psychique objet du droit
Géraldine Aidan
CNRS ed., 360p., ISBN 9782271094995
Ces dernières décennies, un phénomène juridique et politique d’ampleur a vu le jour : l’immixtion du droit dans la sphère intime
des individus.
Cet ouvrage vise à montrer la prise en compte croissante de la dimension psychique des personnes par l’État. L’intérêt porté à l’intériorité ne se limite plus à la volonté et à ses déclinaisons, mais s’ouvre désormais à l’identité, au sexe, à la souffrance, à la filiation psychiques comme au libre épanouissement et au bien-être. Désormais, les préjudices d’anxiété ou les troubles de stress post-traumatiques sont juridiquement reconnus, et les comportements psychiques encadrés au même titre que les comportements physiques.
Cette évolution marque l’émergence d’un sujet psychique dans la sphère juridique et invite à repenser les usages du corps dans le droit et la science du droit.Cet ouvrage déplace le regard vers la dimension intérieure de la personne et s’attache à identifier, décrire et analyser les normes juridiques visant un fait psychique. Comment sont-elles organisées ? Comment évoluent-elles ? À quelles conditions est-il possible de connaître concrètement un fait par nature non directement observable ? Quels procédés et nouvelles sciences les acteurs du droit mobilisent-ilspour s’en emparer ? Dans quelle mesure l’encadrement juridiquedes psychismes individuels est-il devenu un enjeu majeur de nos politiques publiques ?L’introduction de la psyché dans le droit d’États démocratiques constitue une nouvelle étape décisive de la modernité et la psychépolitique un nouveau versant de la biopolitique contemporaine.
La non-discrimination en droit public français
Un principe en devenir ?
Jimmy Charruau
Larcier, coll. A la croisée des droits, 829p., ISBN 9782802768715
Issu du droit américain et repris en droit international et européen, le terme « non-discrimination » n’est apparu que récemment en droit public français, soit pour évoquer simplement le « droit de la non-discrimination » (i.e. le régime juridique entourant l’interdiction des discriminations), soit pour le renvoyer à un « principe venu d’ailleurs », soit au contraire pour le réduire à une référence synonymique au traditionnel principe d’égalité français. Au-delà de ces automatismes, jamais le concept n’est analysé pour lui-même ; si bien que la non-discrimination, confrontée au droit public français, paraît relever d’un impensé juridique.

En tant que principe combinant interdiction efficace des discriminations et promotion utile des différenciations, la non-discrimination pourrait pourtant répondre aux limites du raisonnement aujourd’hui tenu à partir du principe d’égalité, lequel ne semble plus entièrement suffire pour répondre aux réalités sociales contemporaines. Relevant à l’origine du droit anglo-saxon, la non-discrimination pourrait bien se conformer à la tradition juridique française empreinte d’universalisme, en ne visant rien d’autre que la recherche de l’intérêt général ou, plus exactement, de l’« utilité commune » (article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). Plus centrée sur la manière de vivre en commun que sur l’exacerbation de droits strictement catégoriels, elle mériterait ainsi d’être élevée au rang de principe constitutionnel.
Cet ouvrage a reçu le prix de thèse « Droit, Justice et Équité ».
Le service public 12ème ed.
Jacques Chevallier
PUF, 2022, 128 p., ISBN 978-2-7154-1221-7
La notion de service public a acquis une place singulière en devenant, au xxe siècle, emblématique du modèle français de l’État : ligne de démarcation entre le public et le privé, elle est l’incarnation d’un État préposé à la satisfaction des besoins collectifs. Les services publics jouent un rôle structurel et structurant dans la société française : ossature de la vie collective autant que garants de l’accès de tous à certains bien essentiels, ils ont été conçus comme un instrument privilégié d’intégration et de cohésion sociale.
Cette conception a été ébranlée au cours des dernières décennies par la dérégulation néolibérale. Mais si la réduction du périmètre des services publics s’est accompagnée d’une banalisation de leur statut au nom d’un impératif d’efficacité, le service public n’en est pas devenu pour autant une notion vide de sens.
Dans cet ouvrage, Jacques Chevallier entend décrypter les différentes significations de la conception française du service public et analyser sa dynamique actuelle.

L'indépendance écossaise à l'ombre du brexit Juliette Ringeisen- Biardeaud
ed. Panthéon-Assas, coll. essais, 350p., ISBN 9782376510505
Le 28 juin 2022, la Première ministre écossaise a annoncé vouloir organiser un second référendum sur l'indépendance de son pays, après l'échec de celui d'octobre 2014 où une majorité des Écossais avait préféré rester au sein du Royaume-Uni plutôt que devenir un État indépendant membre de l'Union européenne. Ce référendum avait déjà soulevé de nombreuses questions : quel peut être le rôle de l'UE dans ce souhait d'indépendance, elle qui a, de tout temps, combattu le nationalisme ? En quoi le fonctionnement de l'UE rend-il si désirable le statut de petit État membre par rapport à celui de région dotée de pouvoirs législatifs ?
Ce livre donne les clés civilisationnelles, juridiques et politiques pour comprendre la relation triangulaire entre l'Écosse, le Royaume-Uni et l'Union européenne, sur fond de Brexit dur, alors que 62% des Écossais ont voté contre la sortie de l'UE.

La France et le Royaume-Uni à l'épreuve de la pandémie de Covid-19
Antoine A., Blick A., Gadbin-George G., Gibson-Morgan E. (dir.)
Mare & Martin, coll. Droit & Science politique, 267 p., ISBN 978-2-849934-649-5

Depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en 2020, la formule a été maintes fois répétée par les acteurs de cette crise inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, en France comme au Royaume-Uni. Comment ces deux États qui sont soumis à plusieurs crises politiques et sociétales depuis plusieurs années, y font-ils face ? Cet ouvrage se propose de porter unregard comparatiste et pluridisciplinaire sur la gestion de la pandémie par les pouvoirs publics, les services de santé et les acteurs du secteur sanitaire français et britanniques. Les contributions proposées émanent d’universitaires et de praticiens du droit, de la santé et des sciences sociales, assortis d’une analyse historique et socioculturelle de la pandémie par des spécialistes de civilisation française et britannique. Par une démarche concrète et contextualisée, les auteurs examinent les modalités de mise en œuvre de la riposte contre la pandémie par les institutions, mais aussi l’adaptation dans l’urgence qu’elle a imposée aux entreprises, aux professions libérales, aux bénévoles ou à des secteurs particulièrement sensibles comme l’administration pénitentiaire.
L'avenir de l'Union économique et monétaire : une perspective franco - allemande
Kalflèche G., Perroud T., Ruffert M. (dir.)
LGDJ, coll. droit & Economie, 229 p., ISBN 978-2-275-060667-5

L'époque actuelle est une période clef pour le renouveau de l'Union européenne économique et monétaire. Cependant, dans le domaine économique, les divergences franco-allemandes sont visibles depuis le début de la construction européenne. D'un côté, un étatisme social qui parfois se méfie de la théorie et de la pratique des marchés ; de l'autre côté, une empreinte ordo-libérale fondée sur l'économique sociale du marché (« soziale Marktwirtschaft ») ainsi que sur le « miracle économique » (« Wirtschaftswunder ») des années 1950. Les discussions actuelles sont toujours influencées par ces divergences.
L'ouvrage veut combler une lacune de la recherche en droit public (et même en droit en général). Il n'y a que peu d'analyses franco-allemandes sur ce sujet. Les contributions réunies ici sont issues d'un colloque qui a lieu à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) au printemps 2017. Elles traitent la question dans ses différents aspects : la méthode juridique et son enrichissement par la perspective interdisciplinaire avant tout, puis les bases historiques de la construction juridique actuelle.
Le tournant social de l'international. Les organisations internationales face aux sociétés civiles
Lagrange D., Louis M., Nay O. (dir.)
Presses universitaires de Rennes, Coll. Res publica, 202 p., ISBN 9782753579224
Tenues d’opérer un « tournant social », les institutions internationales apprennent à intervenir dans une société mondiale de plus en plus complexe, ouverte et fragmentée. Les assemblées politiques et les administrations, exposées à la pression des acteurs transnationaux, mettent en place des mécanismes de participation dans le but de mieux organiser et canaliser l’expression des demandes sociales sur la scène internationale. Cet ouvrage propose une sociologie politique des organisations internationales, à partir de différents cas d’études (Nations Unies, Banque mondiale, OMC). Il explore ainsi les dynamiques d’ouverture institutionnelle d'un système multilatéral.
Avec une postface de Bob Reinalda.
Avec le soutien du Centre européen de sociologie et de science politique, l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et du laboratoire Pacte de l’université Grenoble-Alpes.

Régénérer la démocratie par les territoires
Lebreton C., Rouquan O.

L'Harmattan, ISBN 978-2140208171
En 1982, lorsque l'acte 1 de la décentralisation est voté, il est un enjeu démocratique. Aujourd'hui, les collectivités locales sont devenues un objet de gestion technocratique. Les récentes lois portant sur les territoires sont illisibles et trop complexes. Dans un premier temps, cet essai veut parier sur le lien au territoire comme levier de regain démocratique. Il faut susciter de l'engagement de proximité afin de restaurer progressivement la légitimité des institutions. Les auteurs y avancent des idées, parfois audacieuses. Puis, ils proposent de redessiner l'articulation entre le local et le central, en régionalisant l'État. Enfin, en partant de l'autonomie des territoires, ils souhaitent un projet plus général de démocratie ascendante par laquelle tout un chacun s'approprie les enjeux forts et délègue le moins possible aux représentants.
La transformation numérique du service public : une nouvelle crise ? Cluzel-Métayer L. (dir.), Prébissy-Schnall C. (dir.), Sée A.(dir.)
Mare Martin, 2022, 352 p., ISBN 978-2-849-346-068
Le service public subirait-il, du fait des transformations numériques, une nouvelle crise ? Conçue comme une réponse aux crises budgétaires et sanitaires actuelles, l’utilisation du numérique dans les services publics est devenue incontournable. Son déploiement à marche forcée depuis mars 2020 est même une condition de la continuité, voire de l’existence, du service public. En résulte, à un niveau micro, un véritable bouleversement des relations avec les usagers et du travail des agents ; en résulte également, à un niveau plus macro, une mutation de la gestion du service public, de ses principes de fonctionnement et de ses moyens, juridiques comme humains. Le numérique conduit enfin, inévitablement, à un renouvellement des institutions administratives et de l’Etat lui-même, qui se mue en un Etat plateforme. Crise ou simple évolution ? Cet ouvrage propose d’interroger les ressorts et les impacts de ces transformations sur le service public et sur son droit.

Le conseil constitutionnel à l'épreuve de la déontologie et de la transparence
Perroud T.; Lemaire E.
IFJD, coll. colloques & Essais, ISBN 978-2370323422

Depuis le début des années 2000, la progression de la culture de la déontologie a conduit au renforcement des exigences éthiques applicables aux institutions publiques, par la multiplication des outils et instruments déontologiques et le renforcement des obligations pesant sur les acteurs politiques, les responsables publics, les fonctionnaires, les magistrats et les agents publics. Ces progrès ont relativement épargné́ le Conseil constitutionnel, qui est resté en marge de ce mouvement. Alors que l'institution s'est radicalement transformée depuis 1958, endossant notamment (depuis l'entrée en vigueur de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité́) des missions proprement juridictionnelles, les règles de droit constitutionnelles, organiques ou réglementaires relatives à sa composition, au statut de ses membres, à son organisation et à son fonctionnement n'ont, quant à elles, qu'assez peu évolué́. Cet ouvrage se propose de pointer les difficultés que soulèvent, du point de vue de la déontologie et de la transparence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'un des principaux gardiens de notre État de droit.
Sociologie politique de la menace et du risque
Marc Milet
Armand Colin, Paris, 208p, ISBN 978-2200629892
Le moment historique de la pandémie de coronavirus a indéniablement placé la gestion publique des crises au centre des agendas politiques mondiaux. Si la question de la gestion des crises par les pouvoirs publics n'est pas nouvelle, la mutation des menaces intentionnelles comme le terrorisme, et l'avènement de nouveaux risques (technologiques ou sanitaires) viennent cependant renouveler leur analyse. Cet ouvrage présente, de manière syncrétique, les grands auteurs, modèles analytiques et approches permettant d'appréhender ces phénomènes dans nos sociétés contemporaines. Quels sont les usages politiques du risque dans le cadre de la compétition politique, de la gestion publique ? Quelles conséquences les menaces et les risques ont-ils sur les résultats électoraux ? Quel est le rôle des acteurs de la société civile dans la construction des risques (le cadre des mobilisations collectives) ?
Un ouvrage assorti de nombreuses études de cas (menace terroriste, affaire du sang contaminé, rôle de l’OMS dans la gestion de la crise du coronavirus, etc.).

Droit de l'aide et de l'action sociales, 11ème ed.
Borgetto M.; Lafore R.
LGDJ, coll. Précis Domat, 792p., 2021, ISBN 978-2275093000
Conçus comme compléments de la sécurité sociale à destination de catégories ciblées de la population (enfance en danger, personnes âgées, personnes en situation de handicap, en difficultés sociales), les dispositifs nés des lois d'assistance de la IIIe République connaissent depuis plus de trente ans un développement continu.
Cet ouvrage propose une approche compréhensive des politiques et des interventions d'aides sociales : loin de s'en tenir à une description du droit positif, il s'efforce au contraire de les situer dans leurs cadres théoriques, d'analyser leurs déterminants sociopolitiques, d'en comprendre les enjeux et de fournir ainsi des éclairages débouchant sur la réflexion et l'action.

Manuel de droit fiscal européen et comparé
Jean-François Boudet
Bruylant, 342 p., ISBN 978-2-8027-6677-3
.jpg)
Cet ouvrage part d’un présupposé : l’impôt n’est pas seulement une contribution obligatoire requise des personnes physiques et morales pour assurer le service des charges publiques, il est aussi une manière de « faire » société au-delà d’un simple processus structurel étatique et d’un partage de compétences fiscales au sein d’un système complexe.
De cette manière, le droit fiscal européen se définit à la fois comme un droit fiscal appliqué à l’UE et comme un droit européen appliqué à la fiscalité. Il s’appuie – mais pas seulement – sur des mécanismes juridiques tirés des traités et interprétés de manière très constructive par la Cour de justice de l’Union européenne. Fondamentale, cette approche est insuffisante à elle seule pour comprendre la fiscalité européenne et le recours à la comparaison permet de conjuguer les caractéristiques structurelles du droit fiscal avec les traditions juridiques générales de la fiscalité dans leurs propres substances (différents types d’impositions, rôle des administrations fiscales, formulation de politiques fiscales, comportements fiscaux individuels et collectifs, etc.).
Le droit administratif aujourd'hui. Retours sur son enseignement
Voizard K-H.; Caillosse J. (Dir.)
Dalloz, coll. Thèmes Et Commentaires, 2021, 750 p., ISBN 978-2247206674
Maîtriser la complexité du droit administratif.
Le droit administratif regroupe l'ensemble des règles spécifiques applicables à l'organisation et à l'action de l'administration, ainsi qu'à son contrôle.
Cet ouvrage mène une reflexion en profondeur sur les modalités de transmission du droit administratif et les évolutions de cette discipline. Il traite également des difficultés que peut présenter l'enseignement du droit administratif à l'heure des grands changements universitaires.


Penser la GPA
Daniel Borrillo, Thomas Perroud
L’harmattan, ISBN 978-2-343-22578-4, 2021
Depuis les années 80, la France interdit la gestation pour autrui (GPA) et, surtout, ne parvient pas à mener un débat apaisé sur le sujet alors que les demandes d'inscription à l'état civil français d'enfants nés de cette technique à l'étranger ne cessent d'augmenter. Les contributions réunies dans cet ouvrage tentent chacune de présenter à la fois un point de vue théorique sur la question et les solutions possibles pour l'ensemble de protagonistes (l'enfant, la mère porteuse, les parents d'intention, les médecins, les autorités françaises...). La GPA est ici saisie sous tous ses angles, historiques, politiques, philosophiques, juridiques. La théorie politique, les études féministes, la sociologie le droit, le droit comparé, l'histoire du droit sont mobilisés pour tenter, au-delà des peurs, de penser sereinement ce phénomène
The Function of Equity in International Law
Catharine Titi
Oxford University Press (11 juin 2021) ISBN: 9780198868002.
A principle with a long pedigree, equity has been present in legal thought and in municipal legal systems since antiquity. Introduced in international legal decisions through claims commissions and arbitral tribunals, equity became progressively part and parcel of the international law mainstream. This book provides a systematic and comprehensive study of the legal concept of equity as it operates in contemporary international law, setting it on a new basis and dealing with some common misconceptions about it. In contrast with earlier studies on the topic, the book is informed by a body of judicial and arbitral case law that has never been so large and varied and it draws extensively on the prolific case law of investment tribunals, gaining insights from a valuable source that is typically ignored in public international law scholarship. From international cultural heritage law to the law on climate change, from maritime boundary delimitations to decisions on security for costs in investment arbitration, the relevance of equity is more far-reaching than has previously been conceded. As the importance of international law increases, continuously covering new domains, the value of equity increases with it. It is this new function of equity in the international law of the 21st century that this book explores.




